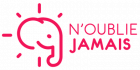Sommaire
ToggleConnaissez-vous Alan Turing ?
Dans les années 1930, ce mathématicien de génie a créé le concept de « machine universelle », c’est à dire une machine qui pourrait réaliser les tâches de n’importe quelle machine. Ce concept joue un rôle décisif dans la victoire de la Seconde Guerre Mondiale en créant une machine capable de décrypter les messages codés par la machine à coder des allemands, Enigma.
En 1950, alors qu’il travaille sur la conception des premiers ordinateurs, Turing publie un article où il pose la question suivante : peut-on imiter le fonctionnement de la pensée par une machine ? (Turing, 1950)
C’est le point de départ des sciences cognitives pour deux champs de recherche répondant aux questions suivantes :
- A quelle logique obéit la pensée ?
- Et : Comment reproduire cette logique avec une machine qui fait des calculs ?
1. Les sciences cognitives
Le terme retenu pour décrire la logique de la pensée est « cognition ». Des chercheurs provenant de différents champs scientifiques s’associent dans les années 1950 pour répondre à ces énigmes : c’est à partir de ce moment qu’on a commencé à parler de sciences cognitives.
Nous pouvons tous constater que nos dispositifs numériques, smartphones, tablettes, ordinateurs, Internet, développent de plus en plus de compétences que nous pensions être propres à l’esprit humain. Nous pouvons aujourd’hui commander nos smartphones en leur parlant, les déverrouiller en leur montrant notre visage et leur faire confiance pour nous guider durant nos trajets en voiture. Toutes ces technologies s’appuient sur des règles logiques auxquelles notre cerveau obéit : les règles de la cognition.
Une source de compréhension du fonctionnement du cerveau est la neurologie, la discipline médicale qui s’intéresse aux lésions du cerveau. L’observation des dysfonctionnements de la pensée et du comportement des patients selon leurs lésions cérébrales ont permis d’identifier l’implication de différentes structures cérébrales dans la pensée et le comportement. C’est le point de départ des neurosciences et de la neuropsychologie.
Ces progrès nous permettent de nous appuyer sur l’ordinateur pour illustrer le fonctionnement du cerveau. Pour commencer, cette analogie va permettre de distinguer plus facilement la différence entre les neurosciences et la psychologie cognitive, deux disciplines majeures des sciences cognitives.
Si notre cerveau était un ordinateur, l’approche des neurosciences serait de le démonter pour étudier ses composants. L’approche de la psychologie cognitive, elle, se situe à un autre niveau : l’objectif est d’analyser ce qui s’affiche sur l’écran selon ce qu’on tape sur le clavier, c’est-à-dire son comportement.
Ces deux disciplines s’éclairent l’une l’autre. Par exemple, en suivant des patients dont le cerveau était abîmé avec des lésions cérébrales particulières ou localisées, les neurologues ont établi des liens entre les structures neurologiques et les fonctions cognitives associées à ces structures.
Bien que les deux disciplines s’éclairent l’une l’autre, l’approche privilégiée pour étudier l’apprentissage et son optimisation est la psychologie cognitive car les résultats qui découlent de la recherche sont plus facilement applicables sur le terrain.
2. Qu’est-ce qu’on entend par fonctions cognitives ?
Les fonctions cognitives sont des sous-unités fonctionnelles nécessaires au traitement des informations que nous percevons et au déclenchement de divers comportements pour y répondre.
Voici les grandes fonctions cognitives et leurs principales interactions.
- Notre attention, c’est la fonction qui
- détermine l’allocation des ressources cognitives
- notamment en l’orientant vers une cible.
- Ceci permet d’augmenter la sensibilité : c’est en quelque sorte un système d’amplification du signal
- La cible de l’attention est toujours une perception
- La perception peut être
- Externe -> ce qu’on voit, ce qu’on entend
- Interne -> discours intérieur, nos images mentales
- La mémoire
- Permet d’interpréter ce qu’on perçoit
- Elle stocke également tous nos programmes mentaux et moteurs, ainsi que nos objectifs.
- Nos programmes mentaux et moteurs servent à nos fonctions exécutives pour planifier et exécuter des tâches en vue d’atteindre nos objectifs.
- Notre motricité nous permet de mobiliser nos muscles pour parler, regarder ou agir dans le monde physique.
- Nous avons une fonction cognitive qui permet partiellement de surveiller et de piloter les autres fonctions cognitives. C’est pour ça qu’on l’appelle la métacognition. La métacognition est le chef d’orchestre de nos fonctions cognitives.
- Elle permet d’orienter l’attention vers les autres fonctions cognitives pour les surveiller
- et de les piloter en s’appuyant sur les fonctions exécutives.

3. Les étapes de l’apprentissage
Toutes ces fonctions cognitives interagissent entre elles pour franchir plusieurs étapes indispensables à l’apprentissage.
Premièrement, établir un objectif comme « apprendre à programmer » nécessite de croire dans sa capacité à développer cette nouvelle compétence.
Deuxièmement, passer à l’action et maintenir l’effort jusqu’à atteindre son objectif demande de la volonté.
Troisièmement, franchir les obstacles demande de mobiliser ses ressources intellectuelles en se concentrant.
Quatrièmement, revoir le cheminement de sa pensée conduit à faire évoluer sa compréhension.
Cinquièmement, la sauvegarde des progrès demande de mobiliser ses apprentissages dans le temps.
Ces nouveaux apprentissages influent sur nos croyances, ce qui boucle le cercle.
Des difficultés peuvent survenir à touts ces étages et conduire à des déviances ou à des blocages. Pour atteindre son but d’apprentissage, il faut maintenir sa direction et son rythme d’apprentissage : c’est l’autorégulation.

N’oubliez jamais que
- L’esprit humain s’élabore sur des sous-unités de traitement de l’information : les fonctions cognitives. La psychologie cognitive s’applique à les décrypter
- Toutes ces fonctions concourent à l’apprentissage et nous verrons comment optimiser l’apprentissage en nous appuyant sur ces fonctions cognitives
- La métacognition nous permet de prendre conscience et d’agir sur notre propre fonctionnement cognitif
- Les fonctions cognitives ne sont pas figées : elles se construisent et évoluent selon l’usage qu’on en fait. C’est ce qu’on appelle la plasticité cérébrale.
Bibliographie
Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 23–65.